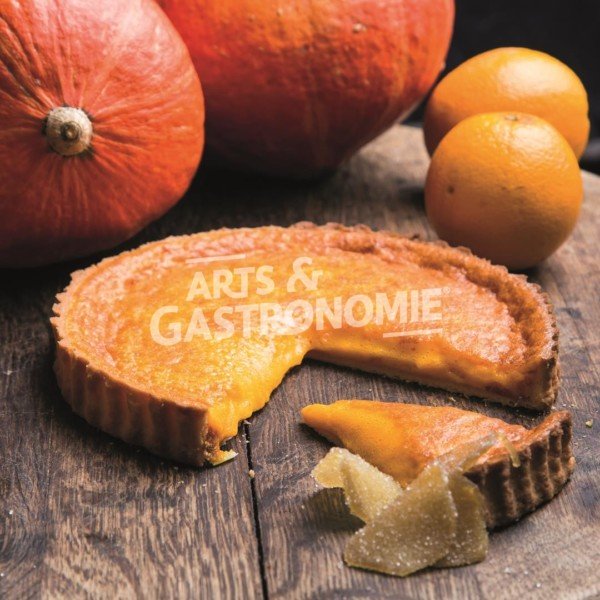Comment a évolué votre cuisine durant ces 20 dernières années ?
L’ADN de ma cuisine, c’est le goût. Elle s’est épurée et a pris en élégance. Nous avons supprimé tout ce qui était superflu, pour se concentrer davantage sur le produit. J’ai toujours gardé à l’esprit l’envie de surprendre, avec une saveur ou une présentation. Et par-dessus tout, j’ai conservé la gourmandise. La cuisine fusion m’ennuie. Parce que ce n’est pas de la cuisine.
Comment parvenez-vous à la renouveler ?
La saison, c’est la première source d’inspiration. Notre esprit de création est toujours en éveil. Une photo, un vieux livre dans lequel je prends goût à me replonger. On croit souvent que notre idée est neuve, alors qu’elle a déjà été réalisée.
Avez-vous déjà été confronté à cette situation ?
Le ris de veau piqué aux anchois. Je voulais apporter un côté salin et proposer un mariage terre et mer. Et quelques mois plus tard, je découvre dans un livre que cette alliance avait en réalité déjà été proposée. Cela arrive fréquemment. Le mariage du poireau et de l’huître, n’a rien de novateur. Ce qui est nouveau, c’est le contenant. On présente le poireau étuvé et grillé et cela lui donne un goût différent.
Les macaronis à la truffe incarnent votre plus grand succès. Toutefois, n’est-ce pas frustrant qu’une cuisine puisse être résumée à un seul plat, si bon soit-il ?
C’est gratifiant au contraire. Je serai toujours associé aux macaronis dans l’histoire de la cuisine. Pour autant, les clients viennent goûter les macaronis mais je n’ai pas l’impression que toute ma cuisine ne se résume à ce plat.
Est-ce qu’un autre plat aurait mérité autant de reconnaissance ?
Le poireau avec l’huître. Même s’il est beaucoup plus récent. Toutefois, c’est une recette plus clivante à cause de l’huître. Les macaronis plaisent à tout le monde.
Et techniquement, quelle assiette vous a demandé le plus d’ajustements ?
Le lièvre à la royale. J’ai mis 25 à 30 ans pour mettre au point la recette. Lorsqu’on est jeune cuisinier, on doit s’approprier celle des autres chefs. On essaye de puiser dans le meilleur de chacun pour réaliser son propre lièvre. J’ai voulu décortiquer le plat pour en extraire les meilleurs éléments. J’ai imaginé un lièvre en ballotine, en prenant les meilleurs morceaux, donc les épaules. Pour la farce, il fallait un bon équilibre entre le cochon, le lièvre, le sang, les foies, le foie gras, la truffe. La cuisson devait donner une texture confite à la viande. La recette cuit 36 heures. On récupère le fond de cuisson pour monter la sauce. On l’accompagne d’une raviole de topinambour, céleri et truffe, avec un soupçon de châtaignes. Elle est cuite dans une crème de raifort, qui apporte de la fraîcheur au plat.
Au cours de ces 20 dernières années, la cuisine française a beaucoup changé. Le végétal devient le centre de l’assiette. Quelle analyse faitesvous de cette tendance culinaire ?
On en parle beaucoup.
Et quand les clients se mettent à table, ils n’en parlent plus. Ils mangent du sucre et du gras. J’ai l’impression qu’ils abordent le sujet pour se donner bonne conscience. Quand c’est l’heure du repas, ils ont juste envie de se régaler. Qu’il y ait du légume, ou pas. On a toujours travaillé de beaux produits, qu’ils soient bio ou non. Je ne fais pas une cuisine de marketing, je fais une cuisine que j’aime. Que j’aime manger, que j’aime partager.
Réduire les protéines animales de votre cuisine n’est pas une réflexion pour les années à venir ?
Je n’en sais rien, je suivrais mon palais. Lorsque je suis arrivé au Bristol, je ne cuisinais aucun légume. Parce que cela m’ennuyait d’en manger au restaurant. Aujourd’hui, je ne conçois pas ma carte sans un ou deux plats de légume. Les cuisiner apporte une vraie valeur ajoutée. En vieillissant, les envies évoluent. Vous devez les partager avec vos clients parce qu’eux aussi évoluent.
Vous avez également pris le parti de réaliser votre propre farine, à l’aide de blés anciens moulus au sous-sol de l’hôtel…
On a toujours fait le pain au Bristol. Notre démarche s’inscrivait dans la démonstration et le façonnage. On a essayé des farines bio pour renouveler notre proposition. Et cela ne me plaisait toujours pas. Un jour, j’ai rencontré Roland Feuillas (boulanger à Cucugnan, ndlr). J’ai partagé trois jours dans le sud à ses côtés pour m’imprégner de la philosophie du pain. Et on a démarré l’aventure du Pain Vivant au Bristol. On est devenu meunier. On s’est approprié ces blés anciens. On laisse faire la nature.
Le boulanger doit s’adapter à la pâte.
La chocolaterie, dernier projet en date de l’hôtel, permettra aussi d’accueillir de nouveaux gastronomes…
Lorsque l’on aura un espace dédié, oui. Ce qui est important, c’est de réussir à les faire passer la porte tambour. Ils sont potentiellement de futurs clients. Avec ce type de projet, on démocratise l’accès au palace.
Durant ces 10 dernières années, vous avez multiplié les projets, en ouvrant le restaurant Lazare, en signant la carte du Drugstore et en reprenant une table à Saint-Tropez… Ne sont-ils pas le secret de votre longévité au Bristol, dans la mesure où ils vous ont donné l’opportunité de vous essayer à d’autres exercices culinaires ?
Le Bristol, c’est mon laboratoire. C’est vrai, ces projets permettent de souffler. C’est une prison dorée ici. C’est bien d’en sortir un peu pour s’aérer l’esprit.
Lazare propose une cuisine plus accessible. C’était important de toucher une nouvelle clientèle ?
C’est bien de partager notre savoir. Même si la carte n’a rien à voir avec ce qu’on fait à Epicure, c’est bien de faire rêver les clients. Et même si c’est différent, on le fait correctement. On observe cette même rigueur de travail, on choisit de beaux produits. Notre métier, c’est de faire plaisir, que ce soit par le biais d’un trois étoiles ou d’un restaurant de gare.
Au cours de ces 10 dernières années, on a aussi assisté à la starification des chefs. Comment percevez-vous ce phénomène ?
Les chefs ont toujours été starifiés. Paul Bocuse en a été l’initiateur. C’est une bonne chose, au moins on parle de notre métier. Avec ces émissions de télévision, on a donné envie aux téléspectateurs de venir voir nos fourneaux. Les parents ont été incités à cuisiner. Les chefs qui sont passés à la télévision ne sont pas des stars de la cuisine française parce qu’ils ont participé à Top Chef. Ils ont fait leurs preuves après leur passage. Peu d’entre eux ont finalement confirmé.
Vous êtes resté très discret médiatiquement parlant. Pour quelle raison ?
Chacun son métier. Je préfère être meilleur dans mes cuisines que dans la communication. Je satisfais peut-être moins de monde parce que mon restaurant compte 40 couverts, mais
au moins ceux-là repartent heureux.
De nombreux talents de la cuisine française sont passés dans votre cuisine, à commencer par votre bras droit Franck Leroy devenu Meilleur ouvrier de France. Quel est votre secret ?
Plus que le savoir, ce sont les valeurs qui sont importantes à transmettre. Lorsqu’ils repartent, nos collaborateurs ont acquis une méthode de travail. On leur inculque l’esprit de cuisine. Ils sont estampillés Frechon.
A quoi correspond la « marque » Frechon ?
C’est la rigueur au quotidien. Être pointilleux sur tout, que ce soit le dressage, la cuisson, l’assaisonnement. On doit prêter la même intention dans chaque assiette, même s’il y en a cent.
Meilleur ouvrier de France, 3 étoiles, 20 ans de maison au Bristol, des collaborations enrichissantes, que pouvez-vous encore attendre dans votre carrière ?
J’espère fêter mes 30 ans de maison ! (rires) Tant que je me sens bien ici, je resterai. On ne réalise de la bonne cuisine que lorsque l’on s’y sent bien. Les propriétaires de l’hôtel l’ont compris et c’est la raison pour laquelle ils me laissent réaliser des projets annexes. Ils savent que cela me rend heureux.